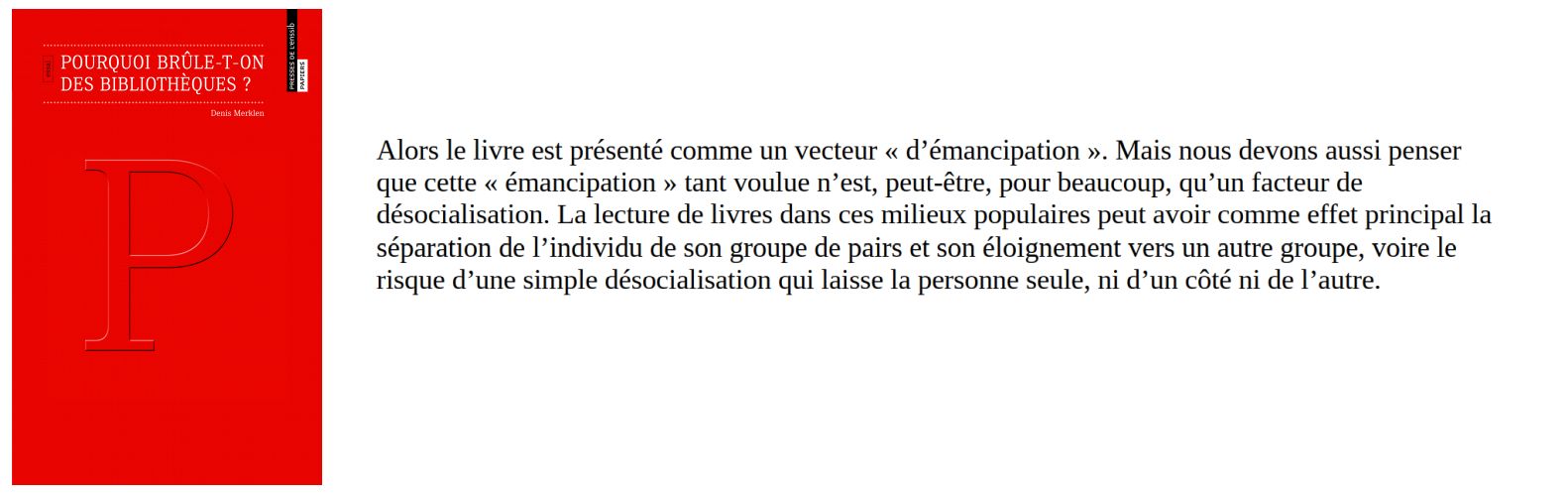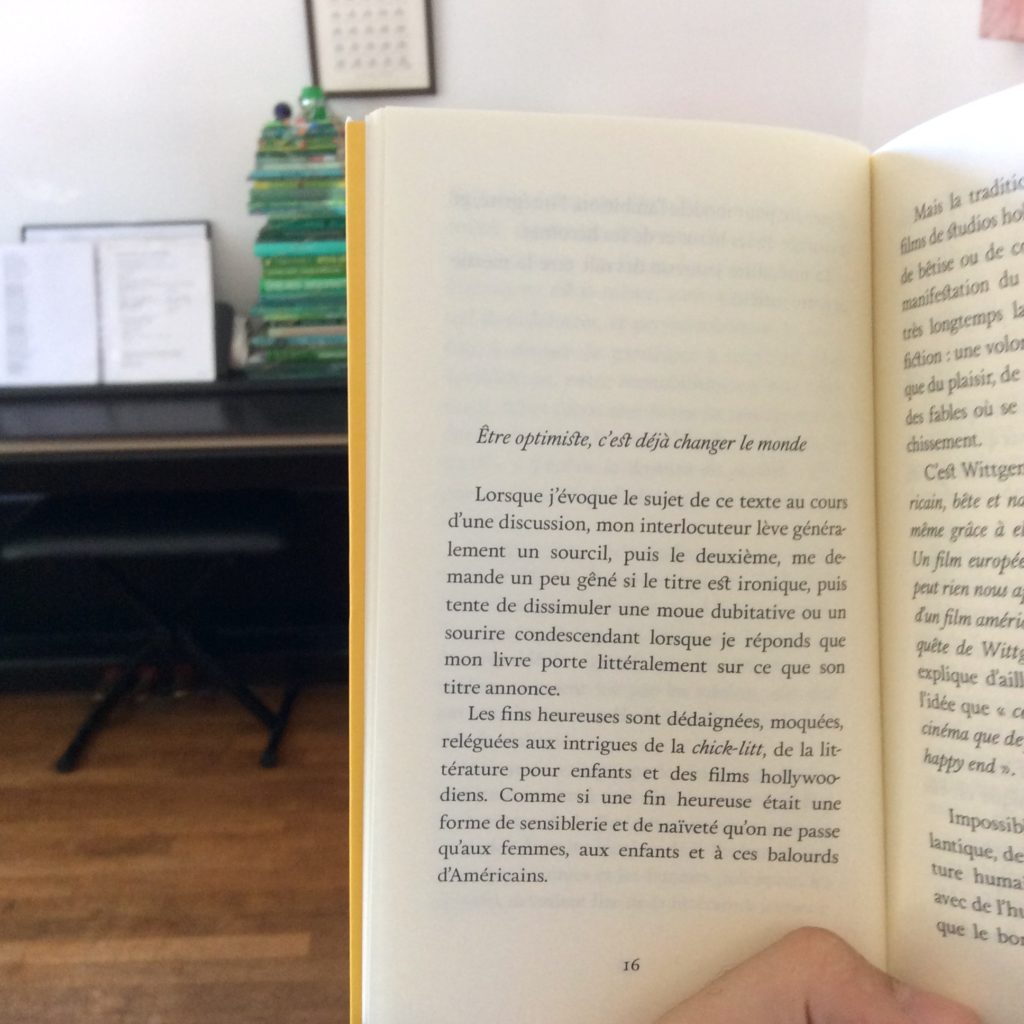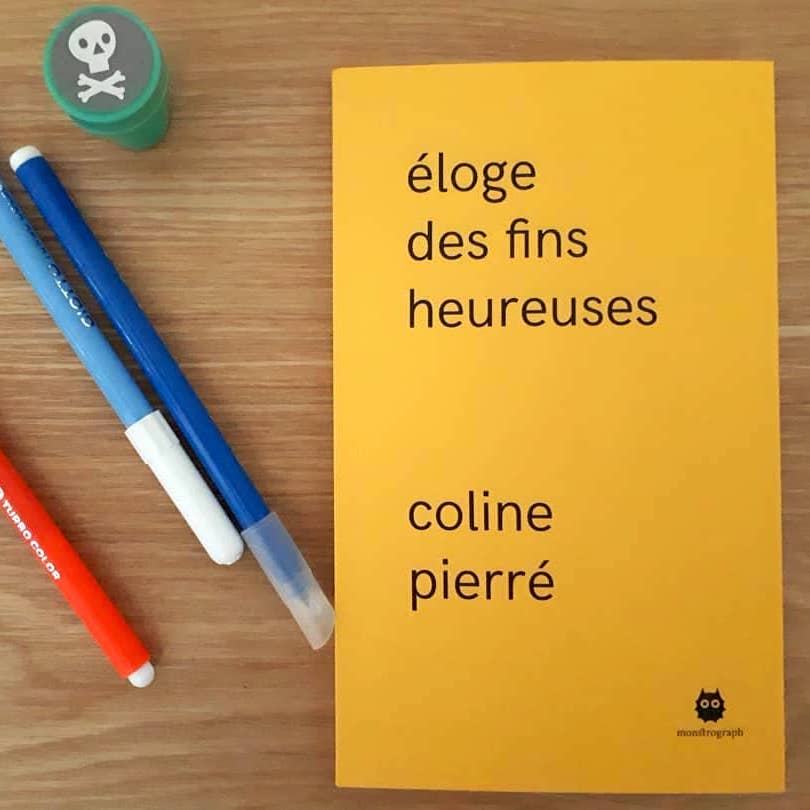Au sein de l’Institut national des études territoriales, différents groupes participent à une veille collective dont les synthèses sont publiées dans la L’Être Auclert, lettre d’actualité des élèves administratrices et administrateurs. Je suis membre de plusieurs groupes et ai fait quelques synthèses d’articles, globalement ce sont des résumés sans grand intérêt de conservation et assez bref, ils servent à partager de l’information. Pour le groupe Culture, j’ai toutefois fait ce point un peu plus détaillé à propos d’un ouvrage fameux de Denis Merklen dans la profession des bibliothèques, et sur sa résonance avec les mouvements sociaux et destructions de lieux culturels ayant suivi le meurtre de Nahel au début de l’été. Pour le coup je trouve intéressant de l’archiver, car il donne une synthèse et des ressources, voici donc :
Si un ministre a pu dire que « comprendre c’est déjà excuser », tous les professionnels travaillant sur les questions sociales, culturelles, et plus largement accompagnant la vie quotidienne, savent qu’il n’en est rien : comprendre, c’est tenter de comprendre, pour mieux prévenir et servir. C’est dans cette optique qu’en 2013 le sociologue Denis Merklen a publié Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Un ouvrage de fonds au titre marquant, qui a fait date, dont les conclusions peuvent s’élargir à d’autres secteurs culturels, et qui résonne dans le contexte post-révolte de cet été.
Dans cet ouvrage il révèle qu’entre 1996 et 2013 70 bibliothèques ont été incendiées en France, dans une relative indifférence. Comment un lieu souvent ancré dans les quartiers, pensé pour l’accès libre et l’émancipation peut ainsi être détruit ? Sans justifier l’attaque d’autres institutions, celle-ci — par exemple celles des maisons de quartiers — paraît insensée. Et le discours général va en ce sens, accompagnant une réaction de perplexité : nihilisme, volonté de détruire, idiotie…
Dans sa grande enquête, débutée à partir des émeutes de 2005 où 13 bibliothèques ont été brûlées, Merklen a fait un large travail d’identification, mais aussi d’entretiens avec des bibliothécaires et quelques personnes condamnées pour avoir brûlé des bibliothèques. La conclusion est claire : le choix des bibliothèques, s’il n’est pas toujours particulièrement motivé, n’est pas absolument anodin, et il a une réalité politique. Malgré l’ouverture maximale des lieux, ils restent incarnés comme des lieux du livre, de l’écrit, et de la culture légitime, souvent en corollaire de l’école. De là, s’y trouve toute une gamme de fractures symboliques qui font de ces lieux ouverts des lieux violemment excluant. De par leur statut de lieu de culture, même s’ils sont portés par les mairies, ils incarnent une sorte de volonté descendante assimilable à un état qui ne reconnaît pas les siens. Par ailleurs, de par la neutralité des fonctionnaires, les employés ne peuvent prendre parti ou agir en militant, de ce fait ils sont forcément du côté de l’autorité. En témoignage cette étonnante déclaration d’un jeune déclarant en 2007 « Si Sarkozy passe, on crame la bibliothèque », quand bien même la ville est PCF et que Sarkozy n’est pas particulièrement lié au monde des bibliothèques.
Merklen ne permet pas d’avoir une réponse à comment éviter de brûler des bibliothèques, mais son ouvrage rappelle combien, malgré un discours médiatique insistant sur des actes sans réflexions, la logique de certaines attaques vient de quelque part. En attaquant un lieu social au cœur de son quartier, on se punit, mais on attaque aussi un exemple de violence symbolique. Une idée qui peut être étendue, en se méfiant toutefois des contextes (2005 et 2023 n’ont pas les mêmes ferments), pour comprendre les actes de cet été, ce sur quoi s’est questionnée une table ronde de l’ABF en juillet. Le sociologue Julien Talpin, suivant Merklen, y a rappelé le rôle profondément « institutionnels » de lieux culturels qui ne sont que peu fréquentés par les habitants des quartiers défavorisés, et qui véhiculent des univers sociaux qu’ils rejettent régulièrement. Talpin souligne que si des services publics sont ciblés ils ne le sont pas tous : dans un quartier l’EPHAD et la piscine ne sont pas ciblés par exemple, le rapport n’est pas le même. C’est assez signifiant même si cela mérite d’être étudié.
Une recette est bien difficile à appliquer, mais dès un texte de 2008 Merklen et Murard soulignaient une voie possible : celui de reconnaître pour commencer que oui, les employés d’établissements culturels ressemblent très rarement aux populations qu’ils veulent toucher. Vivant de la culture et dans un monde culturel, ils doivent forcer leur nature pour réussir à faire entrer plus fortement le public souhaité dans les lieux, et qu’ils se l’approprient. Cela peut paraître injuste étant donné l’important travail sur l’inclusion et les droits culturels, notamment en bibliothèques, mais il reste que la majorité des populations restent des non-publics, et être convaincu de l’injustice d’un regard ne suffit pas. Plus largement, si les bibliothèques doivent assurément continuer ce travail sur elles-mêmes, il faut aussi admettre que la question est plus large et que sans une politique générale de désenclavement des banlieues et d’une lutte générale sur les questions de discriminations et de maintien de l’ordre, en admettant des problèmes systémiques, il n’y a guère de salut possible.
Tout cela est expliqué de manière bien plus détaillée et sourcé sur ces trois ressources, de longueurs comme de support divers :
– L’ouvrage de Denis Merklen est disponible entièrement en ligne sur OpenEdition : https://books.openedition.org/pressesenssib/2139
– Article plus court, exploratoire du livre en devenir : Denis Merklen et Numa Murard, « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? », La Vie des idées, 2008, en ligne : https://laviedesidees.fr/Pourquoi-brule-t-on-des-bibliotheques
– Webinaire « Bibliothèques et mouvements sociaux » de l’ABF, avec Denis Merklen, Julien Talpin et Christophe Evans, juillet 2023, en ligne : https://www.abf.asso.fr/1/22/1038/ABF/webinaire-bibliotheques-et-mouvements-sociaux-des-quartiers-populaires