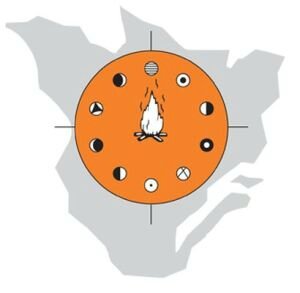Avant de débuter strictement l’entretien, pouvez-vous vous présenter, nos lecteurs ne vous connaissant sans doute pas ?
Rapidement alors, car je vais quand même bientôt avoir 60 ans, alors il y a des choses à dire.
Je suis né dans une communauté Innu, l’une des onze nations autochtones1 du Québec, qui est composée d’environ 19 000 personnes. Je l’ai quittée pour étudier et ai travaillé assez jeune, vers 19/20 ans , dans la communication. Je me suis assez vite investi dans des radios communautaires, je crois que vous appelez ça des radios libres, notamment avec des émissions en langues autochtones.
C’était déjà militant, le saut en politique s’est fait naturellement, j’ai travaillé deux ans vraiment sur ces questions et ai été élu chef en 1992, poste auquel j’ai été réélu depuis. Mais une chose qu’il faut dire, et que même les québécois ont parfois du mal à comprendre, c’est que je ne suis qu’un chef parmi d’autres chefs. Bien sûr je les représente parfois, notamment au sein de l’Assemblée des Premières Nations du Canada, qui regroupe tous les représentant d’Assemblées de chaque région.
C’est un paradoxe qui m’a amené à me pencher sur la question autochtone. Je fréquente pas mal d’indépendantistes, mais la plupart du temps ils me semblaient peu sensibles aux autres nations sur le même territoire, alors qu’ils dénonçaient sans cesse l’acculturation qu’ils subissaient. Les peuples autochtones sont des nations reconnues, avec des cultures, des territoires, j’ai du mal à comprendre pourquoi ils ne jouissent pas de la même autonomie.
Ce qu’il faut savoir c’est que le statut des premières nations est toujours régi par la Loi sur les Indiens, un texte clairement colonial, qui a plus d’un siècle et demi et qui n’a été que très peu modifié depuis. Cette loi régente beaucoup de choses de la vie quotidienne. La modifier est possible mais très complexe.
Prenons le Québec. Ils ont a priori tout pour faire un État qui semble légitime : une langue, un territoire, une culture, et même s’il n’ont pas de pays, ce discours porte. Nous avons des langues, des cultures, mais le problème central c’est le territoire. Le territoire actuellement attribué aux Première Nations, les réserves si vous voulez, n’ont rien à voir avec les terres historiques.
En fait, c’est évident avec mes lunettes, la pleine autonomie c’est l’idéal, le gouvernement autonome autochtone on le vise. Nous nous sentons pleinement légitimes pour exercer l’administration de nos communautés mais l’idéal est vite rattrapé par la réalité… La loi sur les indiens revient toujours dicter ce que l’on doit faire sur l’éducation, le logement, les ressources, etc. Tout cela est guidé par cette antiquité.
L’autre réalité c’est le territoire, j’y reviens encore mais avec la loi sur les Indiens ce sont les problèmes centraux. Aujourd’hui si nous nous revendiquions gouvernement, nous n’aurions ni les outils pour le faire, qui appartiennent au fédéral, ni la terre. Si l’on additionnait tous les territoires autochtones du pays, tous, on atteindrait même pas 1% du Canada actuel, très loin de ce que nous possédions avant la soit disant découverte.
Je ne connaissais pas ce chiffre de 1%, c’est assez édifiant… Quels leviers avez-vous pour changer les choses ?
À moyen terme nous ne pouvons qu’avancer dans un contexte national sur lequel on a plus ou moins de prise. Nous sommes tous d’accord sur la question de la terre, en obtenir plus est une priorité, mais encore faut-il avoir accès aux négociations, etc.
L’histoire géo-politique canadienne fait qu’il y a une différence entre l’Ouest et l’Est. Schématiquement, de l’Ontario aux Rocheuses les nations ont signé des accords au début du siècle dernier et tentent de de faire évoluer les traités. Ils doivent le faire en lien avec la Couronne Britannique car c’est avec elle que les accords ont été signés.
Mais les autres ne sont pas sous l’autorité de ces traités et c’est donc le « titre aborigène » qui fait loi. Ce traité stipule que les nations qui n’admettent pas avoir été conquises peuvent revendiquer leur autonomie. C’est le cas de ma nation, les Innus, mais aussi des Yukons, etc. Ces peuples peuvent donc ouvrir des discussions pour établir les prétendus droits des autochtones adaptés à un contexte contemporain.
C’est long, complexe, coûteux et – même si nous ne le recherchons pas – se termine souvent devant les tribunaux. D’où de nombreuses décisions qui ont été prises par les Cours suprêmes depuis cinquante ans. Mais nous ne sommes pas à égalité dans ce combat car les règles sont fixés par le Canada, qui finance nos revendications et est représenté judiciairement par la Cour.
Paradoxalement, la Cour nous a souvent donné raison contre les gouvernements, et a amélioré nos vies, mais à quel prix ? Et puis ce n’est pas parce qu’une décision est adoptée qu’elle est appliquée, alors il faut à nouveau se battre devant la justice, c’est ce que j’appelle un cercle vicieux.
Vous parliez d’améliorations et de réussites arrachées de haute lutte, pouvez-vous en citer quelques-unes ?
Récemment encore une décision a reconnu la légitimité de la pêche commerciale pour certaines nations de Colombie-Britannique. Ce n’est pas rien, mais il y aura un appel du Canada. C’est un vrai paradoxe car le gouvernement est justement chargé de la protection des autochtones et pourtant, à chaque avancée, il va en appel contre son propre droit. Une autre réussite : l’obligation de consulter les autochtones quand une loi peut affecter le droit des nations.
Mais toutes ces négociations sont très dépendantes d’un environnement politique que l’on contrôle plus ou moins, au niveau fédéral et provincial. Donc on peut avoir des réussites mais il faut toujours être vigilant.
Exemple en 2012, le Parti Québécois est arrivé au pouvoir. Comme on a eu très peu de succès avec le précédent gouvernement2, on s’est dit qu’avec celui-ci on pourrait peut-être discuter de nation à nation. On est engagé dans cette voie là, dans une opportunité idéale pour exposer certains principes qui nous sont chers. Mais ce sont des processus lourds et le temps politique est court. Là au Québec, on est en phase quasi-pré-électorale. Dans ce cas il faudra réussir à inscrire la question autochtone dans les priorités de la campagne, même si c’est rarement le cas. Le positif, c’est que malgré ce manque d’attention, nous avons quand même plus de visibilité et avons réussi à rendre la cause incontournable.
Nous avons la chance d’avoir une population jeune, très ouverte sur le monde, notamment au travers des réseaux sociaux ; une génération qui semble plus intéressée par la chose politique, par ce qui les touche. Ils savent transmettre leurs points de vue.
Je terminerai en disant que le chemin parcouru transcende les frontières. On se réunit à chaque printemps au siège de l’ONU avec la commission sur les autochtones. Notre but est que les 147 états qui ont signé la Déclaration sur les droits des peuples autochtones l’appliquent réellement. En dépit de la faible marge de manœuvre, on peut se réjouir de ces avancées.
J’aimerai parler d’un autre aspect des relations autochtones-canadiens : celui du racisme qui est souvent évoqué sur divers sites internet. Il y a des exemples frappant, comme l’homicide sans raison du jeune Terry Lalo par la police en 2002 et beaucoup de témoignages de racisme ordinaire. Vous qui avez une vue large, pensez-vous que la problématique a quand même avancé ?
Une chose est claire : plus on est revendicatif sur les questions identitaires et plus on reçoit de réactions opposées à nos positions chez les non-autochtones. Il y a toujours, à un certain égard, un racisme quotidien : l’autochtone est forcément ivrogne, analphabète, vivant aux crochets de la société…
C’est sans doute moins fort qu’il y a trente ans et ce n’est pas quelque chose que l’on constate dans les centres urbains. Ça se ressent plus en région, là où l’extraction de ressources naturelles est la base de l’économie. C’est dans ces contextes que nos communautés sont les plus affirmées : soit elles veulent garder le territoire intact, soit elles veulent prendre une part active aux travaux, ce qui leur serait bénéfique sur le plan socio-économique.
Il y a des cas ponctuels clairement discriminatoires, ou alors des responsable politiques qui s’énervent lors de réunions. Il y a toujours quelqu’un à ce moment là pour hausser la voix et faire revenir le calme. Cela fait quatre-cent ans que l’on cohabite, il faut parfois des intermédiaires, quelques voix indépendantes qui se lèvent, mais on réussi à tempérer les esprits.
Ces derniers temps, deux grands projets impliquent les communautés autochtones : le « Plan Nord » de Jean Charest, rebaptisé « Le Nord pour tous » par Pauline Marois et la réforme du système éducatif des autochtones. Dans les deux cas les gouvernements affrontent des résistances fortes…
Le principal problème est que l’on ne nous associe pas assez, ce sont censés être des plans de développement de nos terres, mais sans nous ? En toile de fond on revient toujours à la loi sur les Indiens. Plutôt que de lancer de grands projets on devrait déjà parler. Je n’ai rien contre l’idée de partager les ressources, mais depuis un siècle et demi les nations autochtones subissent le développement sans en avoir jamais profité. On veut renverser ça pour que nos peuples soient capables de s’autodéterminer.
Ça m’amène à l’éducation. Cette compétence, en vertu de la loi sur les Indiens, dépend du fédéral. C’est très bien de vouloir l’actualiser, on est tout à fait pour. Il faut la faire évoluer afin de la rendre conforme à la réalité. Mais il ne faut pas que ce soit totalement aux mains du gouvernement fédéral ! Et là il y a un désaccord depuis des années, le gouvernement décide de manière très unilatérale. Et c’est là qu’on est à des années lumières de l’égalité. Nous on ne demande pas mieux qu’une réforme de l’éducation, mais nous avons des comités qui ont travaillé dessus, on a des compétences, de la réflexion… Ce qu’on exige c’est simplement d’être à la table des négociations. Dans un vrai échange.
L’APNQL regroupe dix nations, et quarante-trois communautés. Il y a de vraies différences culturelles et sans doutes des revendications diverses, réunir tout ce monde dans la même direction doit nécessiter une grande diplomatie…
Chaque communauté est autonome à elle même et devrait répondre directement aux questions de sa population. Mais, vu le contexte, il n’y a pas d’autre choix que prendre le temps nécessaire – et il en faut parfois beaucoup – pour faire converger des situations parfois différentes selon des question économiques, géopolitiques, géographiques surtout… On n’a pas les même besoins selon que l’on vive à quinze minutes de Montréal ou à quatre heures !
Mais nous combattons le même système, on converge sur les priorités à défendre face aux gouvernements canadiens et québécois.
Un bon exemple de ce front qui réussit, c’est le rapatriement de la Constitution Canadienne en 19823 : tous les peuples se sont unis pour faire entendre la voix des premières nations. C’est ainsi que la constitution du Canada est devenu une de celles qui, au Monde, a le plus pris en compte le droit des autochtones et, surtout, les droits ancestraux. Plus on fera ce genre de front commun et plus on aura de chance de réussir à obtenir les avancées que nous demandons.
Entretien réalisé via Skype le 25 février
1. En incluant les inuits, qui ne font pas partie de l'APQL.
2. Les gouvernements du libéral Jean Charest, premier ministre du 29 avril 2003 au 19 septembre 2012 (trois mandats).
3. Terme désignant le processus par lequel le Canada est devenu pleinement maître de sa constitution, obtenant notamment le droit de la modifier sans l'accord du Royaume-Uni.
– Ouvrage d’entretiens entre Ghislain Picard et Pierre Trudel ;
Crédit photo : La Presse - Agence QMI