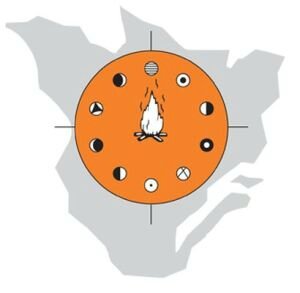Pierre Céré est avant tout un militant associatif et syndical, particulièrement actif dans la défense des précaires. Coordonnateur du Comité Chômage de Montréal depuis 1997 et porte-parole du Conseil National des Chômeurs et Chômeuses, il a fait le saut en politique pour le Parti Québécois dans Laurier-Dorion en 2014. Sèchement battu, il n’a pas renoncé, a repris son bâton de pèlerin et s’est porté candidat à la chefferie du PQ, défendant un indépendantisme social et inclusif.
Vous êtes actif dans le milieu communautaire depuis des années, particulièrement auprès des chômeurs dont vous défendez les droits au niveau local et provincial depuis plus de vingt ans. Comment vous êtes vous retrouvé à travailler pour cette population souvent rejetée à la marge ?
En fait, je suis actif dans les mouvements de chômeurs depuis 1979 quand, avec d’autres camarades, nous avons créé le Regroupement des chômeurs et chômeuses de l’Abitibi-Témiscamingue, une région du nord du Québec. Ce sont les circonstances qui m’ont amené là. L’Abitibi est une région minière où le chômage a toujours été très élevé. J’étais déjà actif dans les milieux militants, il y avait ce besoin de créer une organisation de défense des droits des travailleurs en chômage. Nous l’avons fait. Mes appartenances sont là, elles sont toujours demeurées là, avec les travailleurs et les travailleuses, avec leurs problèmes, à défendre leurs droits.
Vous êtes entré en politique lors des élections de 2014, présenté comme un candidat vedette par le Parti Québécois. Comment se lance-t-on en politique quand on est issu du milieu communautaire, n’y avez-vous pas vu un risque ? Comment cette candidature a-t-elle été accueillie par vos collègues, votre environnement et, de l’autre côté, comment vous êtes-vous senti dans l’arène médiatique avec cette autre casquette ?
J’ai acquis cette conviction, au fil des années, que la société que nous avons bâtie au Québec, au cours des dernières décennies, est une société qui vaut la peine que l’on se batte pour elle. On parle du modèle québécois comme d’un modèle de développement économique et social qui nous est propre et qui est fondé en quelque sorte sur la solidarité et le partage d’une partie de la richesse créée. C’est ce qui explique ces outils de développement économique décentralisées et de proximité, réunissant les différentes forces qui animent la société (patrons, syndicats, mouvements sociaux, coopératives, etc.), accordant un rôle accru à l’État; c’est ce qui explique aussi bon nombre de programmes sociaux qui sont propres au Québec, et qui n’ont parfois aucun équivalent dans le reste de l’Amérique. De façon globale, on peut même dire que le Québec a mis en place son propre modèle de développement, souvent à contrecourant du modèle dominant en Amérique du Nord.
En ce moment, avec le nouveau gouvernement élu au printemps dernier, nous avons affaire à une véritable entreprise de démolition de ces acquis. Ce gouvernement, celui du Parti libéral du Québec, dirigé par Philippe Couillard, manifeste une réelle détermination de s’inscrire dans les grands courants conservateurs cherchant à réduire la taille et la portée de l’État.
Est-ce que j’ai vu un risque à me lancer en politique ? Non. Qui n’ose pas, ne risque pas, qui s’enferme dans une certaine routine, se contentant d’un rôle défini et arrêté, participe peu aux changements. La politique devient le prolongement de notre action. Pourquoi laisser la politique aux professionnels de la politique, aux carriéristes et autres « arrangeurs » ? Un célèbre syndicaliste disait que si tu ne t’occupes pas de la politique, c’est elle qui va s’occuper de toi.
Comment ma candidature a-t-elle été accueillie? Par mes collègues d’organisation, très bien. Ils comprenaient le sens de mon engagement. Par d’autres milieux sociaux, portés par d’autres visions politiques? Avec respect je crois. Comment me suis-je senti dans l’arène médiatique avec cette autre casquette? À l’aise, et sans langue de bois.
Avec 15,93% dans Laurier-Dorion, vous êtes largement battu, devancé par le sortant libéral Gerry Sklavounos (46,19%) et le solidaire Andrés Fontecilla (27,69%). Plusieurs mois après cette défaite, quel regard portez vous sur votre campagne et que feriez-vous différemment ?
Je demeure très fier de la campagne que nous avons menée, des gens qui se sont regroupées autour de ma candidature, du travail que nous avons fait sur le terrain. Il me serait difficile de faire les choses autrement, sinon peut-être de chercher à mieux nous organiser structurellement dès le départ. Sinon, nous avons été emportés par une forte mobilisation de la peur, celle d’un possible référendum sur la souveraineté du Québec, et celle aussi, qui a joué un rôle déterminant dans nos résultats, du projet de charte de laïcité.
Avec un tel résultat, on aurait pu penser que vous seriez retourné au militantisme, dégoûté de l’action politique. Vous avez pourtant décidé de vous lancer dans la difficile course à la chefferie du Parti Québécois, alors que les candidats ne manquent pas. Quelles raisons principales vous ont poussé à vous engager dans l’arène politique? Par ailleurs, les conditions d’inscription ont évolué mais restent complexes, notamment financièrement; à ce jour pouvez-vous effectivement vous présenter ?
Je suis retourné au militantisme ! J’ai repris mes activités au Comité Chômage de Montréal ainsi qu’au Conseil national des chômeurs (CNC).
Ma candidature à la chefferie s’explique surtout par le fait qu’un groupe de militants et de militantes s’est réuni autour de moi avec cette ferme intention de participer au débat des idées qui animerait le Parti québécois. Et il est devenu clair, au fil des semaines, que participer à ce débat impliquait nécessairement de présenter ma candidature à la direction du Parti québécois. Nous avons réfléchi, écrit, débattu et bâti littéralement nos idées et nos propositions. C’est devenu notre programme. Il est progressiste, il est de justice sociale, il s’inscrit dans ce grand modèle que nous appelons le « modèle québécois ». Nous sommes audacieux, refusons la vieille (comme la petite) politique et croyons que le Parti québécois pour mieux se reconstruire doit impérativement se redéployer dans le mouvement social, se reconnecter sur la population, sur la jeunesse, sur les idées émergentes, finalement sur ce que le Québec est devenu et ce qu’il sera demain.
Notre programme est en ligne : www.pierrecere.org
Les conditions menant à la validation du statut de « candidat » ne sont pas simples. Il nous faut recueillir 2000 signatures en provenance d’au moins 50 circonscriptions et 9 régions du Québec, avec chacune au moins 10 signatures. Cela, sans compter un premier dépôt 10 000$ qui doit être versé avec les signatures au plus tard le 30 janvier.
Je le répète : nous n’avons ni fortune, ni personnel salarié. Nous fonctionnons à l’énergie de l’espoir. Et ça marche ! Nous sommes partout et maintenant confiants d’atteindre la barre des signatures. Pour l’argent, nous lancerons bientôt une campagne citoyenne, 100%, c’est-à-dire 100 personnes donnant chacune 100 $.
Vous êtes un candidat « surprise » mais vous avez été l’un des premiers à sortir un programme détaillé. Vous y développez une vision d’un Parti Québécois inclusif et socialement juste, ce qui peut paraître s’opposer à la gouvernance passée. Comment jugez-vous la gestion de la Charte des valeurs et de la laïcité, vous qui aviez dénoncé dès 2007 une dérive identitaire du PQ ?
Il est vrai de dire que je suis un candidat « surprise », et je l’assume. Je ne suis pas député, je n’ai jamais fait de la « politique professionnelle ». Je viens des milieux sociaux et je me fais un point d’honneur de rappeler que je viens d’un milieu ouvrier et que mes appartenances sont toujours restées là.
Le projet de société que nous avançons en est un de justice sociale et d’inclusion. C’est aussi un projet indépendantiste qui se conjugue à la diversité culturelle.
Par ailleurs, il est vrai que nous portons un regard très dur sur cette stratégie identitaire qui a animé le Parti québécois depuis 2007. Cette stratégie visait à récupérer à la droite (Action démocratique du Québec) le sentiment identitaire. En faisant du « nous » et du « eux », on a fini par créer ce clivage avec les communautés immigrantes, leur faisant porter le poids d’une menace : celle de notre survie, celle du projet de pays, celle du fanatisme religieux.
Au lieu de travailler à transformer, là où il le faut, nos institutions, nous avons ostracisé. Au lieu de rassembler, nous avons divisé. Le projet de charte de la laïcité aurait pu avoir une approche rassembleuse, on a fait le contraire. Le problème n’était pas d’avancer avec un projet de laïcisation de l’ensemble des institutions d’État, d’établir des balises, mais plutôt dans la forme, dans la façon.
Le Parti Libéral du Québec élabore en ce moment une énorme casse sociale, cependant l’ère Bouchard, puis le mandat de Pauline Marois, ont semblé s’opposer parfois au « principe favorable aux travailleurs » de René Lévesque. D’abord progressiste, on sent aujourd’hui une grande tentation au PQ de séduire les électeurs de la CAQ, partisans de coupes sociales et de l’austérité. Vous vous posez en garant de la justice sociale, que répondez-vous à ceux qui vous disent qu’elle coûte trop cher ou qu’elle est inefficace et comment envisagez vous la redistribution des richesses dans un Québec où vous seriez Premier Ministre ?
Le Parti québécois demeure un parti fondé sur le projet de faire du Québec, un jour, un pays. Il regroupe, sur cette base, des sensibilités plus à gauche, d’autres plus à droite. Il est vrai qu’à l’intérieur du PQ, un courant aimerait un rapprochement avec la CAQ, et donc un alignement marqué à droite. Cela fait partie des tensions normales qui animent un parti politique comme le PQ. Briser l’équilibre existant lui serait fort dommageable.
La redistribution de la richesse, à tout le moins d’une partie de la richesse créée, les instruments économiques et les programmes sociaux que nous avons mis en place comme société demeurent les grands piliers de notre développement. Je poursuivrais clairement dans cette direction : une économie bâtie pour la population, pour ses besoins, construite dans un modèle de développement durable, l’amélioration des conditions de vie. Des propositions comme les « quatre semaines de vacances obligatoires » seraient mises en chantier, d’autres aussi (voir notre programme). Nous nous engagerions de façon très marquée dans une phase de transition visant à nous départir du pétrole, en accélérant le pas pour l’électrification de nos transports. Il y a beaucoup à faire, de nombreux chantiers à mettre en place. Nous formerions un fabuleux gouvernement !
Aux oiseaux du malheur qui nous prédisent toujours les pires cataclysmes, aux idéologues qui préfèrent une réduction de la taille de l’État plutôt qu’un État fort au service de sa population, à ceux qui nous proposent « d’avancer par en arrière », je leur dis : « nous connaissons vos histoires, nous connaissons vos recettes, elles sont sornettes pour l’une et indigestes pour l’autre ».
Pour ce qui est de l’indépendance, vous proposez de d’abord tenter de négocier un nouveau partenariat avec le Canada, pour plus de dévolution (notamment fiscale), avant de lancer un référendum en cas de refus. N’avez-vous pas peur d’effrayer les plus « pressés », d’autant que rien n’indique que le futur premier-ministre canadien souhaite donner une quelconque autonomie supplémentaire au Québec ?
Notre proposition se résume à l’idée suivante : Souveraineté-association ou Indépendance !
En 1980, nous avons cherché par voie référendaire le mandat de négocier une nouvelle entente fondée sur l’égalité de nos deux peuples (Québec-Canada), par laquelle le Québec devenait le seul responsable de percevoir les impôts et les taxes sur son territoire, acquérant le pouvoir exclusif de faire ses lois et d’établir ses relations extérieures. Nous partons de là, allant chercher ce mandat dans le cadre d’une élection plutôt que par voie référendaire, en d’autres mots, nous éliminons une étape. Une fois élus, nous ouvrons cette négociation à deux, d’égal à égal, de nation à nation. Deux chaises, celle du Québec, celle du Canada. Nous ne négocions pas avec l’ensemble des provinces, comme ce fut le cas lors de l’Accord du lac Meech. Seulement avec Ottawa. L’objectif étant d’en arriver à une entente établissant notre souveraineté dans un cadre associatif. Est-ce que la classe politique à Ottawa aurait suffisamment évolué pour exprimer cette ouverture et mettre en place ce nouveau pacte entre nos deux peuples ? Nous verrions bien.
Mais à défaut de négociation, ou d’en arriver à si peu, devant une possible mauvaise foi, nous fermerons cette avenue après une période d’une année, et engagerons tous nos efforts, toute notre créativité, dans une mobilisation totale vers un référendum appelant à notre indépendance. La question serait simple : « Voulez-vous que le Québec devienne un pays? » Faudrait-il ajouter à pays, le qualificatif « indépendant » ou « souverain » ou tout simplement s’arrêter à « pays » ? Nos militants trancheront !
Notre proposition est claire, notre stratégie se déploiera à visage découvert, au vu et au su de notre population. Nos idées seront exprimées, le chemin que nous voulons prendre sera indiqué. Nous sommes en mode solution et nous comptons arriver à bon port au cours du premier mandat suivant notre élection.
Dans votre programme vous liez fondamentalement emploi et environnement, alors qu’on les oppose souvent. Alors que l’on parle de plus en plus de privatisation de l’électricité et que le gouvernement péquiste de Pauline Marois avait autorisé l’exploration du pétrole de schiste dans l’île d’Anticosti, quelle est votre position sur ces débats ? Et qu’elle vous semble la priorité en terme de protection de l’environnement ?
L’ensemble de nos sociétés se retrouve au même carrefour, et il nous faut choisir : poursuivre ce même développement économique, en bout de ligne irresponsable et assassin de notre environnement et de notre qualité de vie, ou chercher des alternatives qui s’inscrivent dans un développement durable. Le Québec doit de façon solennelle et irrémédiable s’engager dans une phase transitoire pour se départir des énergies fossiles, et poser des gestes concrets, et importants, dans cette direction. Cela implique de mettre en place les structures de recherche, les mécanismes, l’industrie pour assurer à terme que notre transport, l’ensemble de nos moyens de transport, soient électrifiés. En même temps, sachons que cette transition se fera sur plusieurs décennies (trois, quatre, plus ?).
Pendant cette période, si nous continuons d’utiliser du pétrole et autres énergies fossiles, il nous faudra néanmoins en consommer toujours moins. Il faudra tout de même faire des choix : nous le prendrons où ce pétrole au cours de cette transition ? De l’Algérie ? Du Kazakhstan ? Celui des sables bitumineux de l’Ouest canadien ? Pourrions-nous envisager exploiter un pétrole québécois ? Encore faudrait-il connaître ses qualités, ses quantités, la qualité du sol, les impacts environnementaux et ceux possiblement sur la population, les méthodes d’extraction, etc. Et, surtout, ne jamais improviser sur ces questions. Jamais.
Enfin, ce dernier espace vous est laissé libre afin de développer une mesure phare sur laquelle vous n’avez pas été interrogé et que vous aimeriez développer.
La jeunesse québécoise du printemps 2012 a lancé un immense cri sur l’état de notre démocratie, sur nos pratiques. Elle a questionné les frontières peut-être trop étroites de cette démocratie, questionné nos pratiques, les formes de leadership. Il est de toute première importance de lancer un vaste chantier cherchant une refondation de notre culture et de nos mœurs politiques. En la matière, comme en d’autres, nous avons besoin d’une véritable révolution. Le Québec sait les faire « tranquilles » et à la fois systémiques. Allons-y !
Entretien réalisé par courriel
en novembre 2014
Pour aller plus loin
Site officiel
Tribune : « Ce que le PQ pourrait être »
Crédit photos : Pierre Céré par Dominic Morissette, site officiel du candidat.